En quelques mots
Les anémies dysérythropoïétiques congénitales constituent un groupe hétérogène de maladies génétiques très rares caractérisées par une anémie d’intensité variable due à une érythropoïèse inefficace, avec anomalies morphologiques des érythroblastes (Eb) médullaires et une fréquente hémochromatose secondaire.
Les DC peuvent être diagnostiquées dès la petite enfance et même parfois en prénatal. Mais une méconnaissance des critères morphologiques et le grand nombre de diagnostics différentiels à exclure rendent le diagnostic de la maladie compliqué et souvent retardé.
Communément appelées les anémies dysérythropoïétiques congénitales (les CDA en anglais), ces affections sont classées en trois types principaux : anémies dysérythropoïétiques congénitales de type I, II et III.
Cette classification repose essentiellement sur les altérations morphologiques observables sur les frottis médullaires qui permettent d’examiner les aspects des cellules qui produisent les globules rouges, les érythroblastes, ainsi que des altérations biochimiques plus ou moins spécifiques.
Cependant, comme de nombreux cas, eux-mêmes hétérogènes, de DC ne rentrent pas dans ces trois catégories, un groupe IV a été proposé.
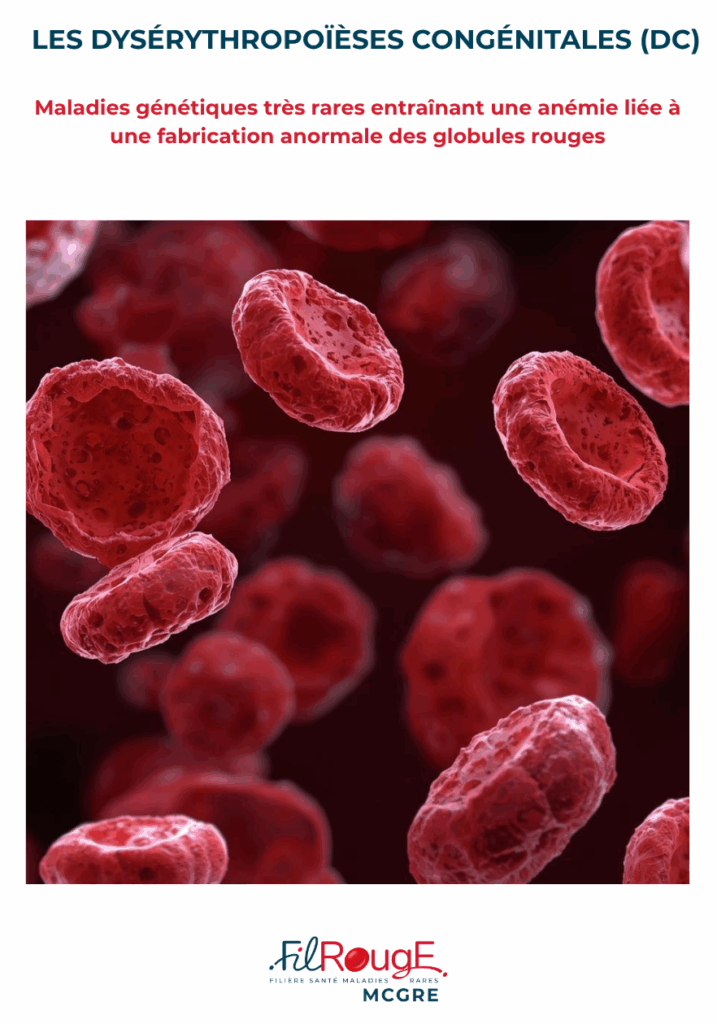
Anémie dysérythropoïétique congénitale type I (CDA I) :
Il s’agit d’un trouble hématologique de diagnostic parfois retardé, mais détectable dès la naissance, caractérisé par une anémie macrocytaire modérée à sévère, associée dans environ 20% des cas à des déformations osseuses des membres ou des ongles, et à une scoliose. Des signes liés à l’hémolyse pathologique peuvent être constatés : augmentation de la bilirubine (ictère) et baisse de l’haptoglobine. L’existence d’une moelle à la fois riche et dysérythropoïétique provoque une absorption intestinale de fer très augmentée et expose les patients aux complications graves des surcharges en fer.
Mode de transmission de la maladie :
La maladie se transmet selon un mode autosomique récessif, c’est-à-dire affectant autant les filles que les garçons et le plus souvent les parents des personnes atteintes en sont des transmetteurs sains. Deux gènes principaux ont été identifiés sur le chromosome 15. Un diagnostic en génétique moléculaire est donc possible. Toutefois les anomalies génétiques doivent être compatibles avec les données de l’examen des érythroblastes dans la moelle. Les principales anomalies sont l’existence anormale de ponts chromatiniens internucléaires et de l’aspect du noyau avec des amas (aspect dit « en gruyère »), des érythroblastes acidophiles et polychromatophiles avec plus d’un noyau, et des élargissements des pores de la membrane du ou des noyaux.
Signes cliniques :
- Anémie macrocytaire la plupart du temps modérée, cependant les formes graves à révélation précoce peuvent être dépendantes de transfusions mensuelles. Des épisodes d’anémie plus marquée avec ictère accentué peuvent survenir et s’accompagner de gonflement temporaire et douloureux de la rate.
- Splénomégalie rarement absente et progressive.
- Hépatomégalie en général liée à la surcharge en fer
- Anomalies congénitales des membres, en particulier de leurs extrémités associées à des ongles malformés. Retard de croissance pouvant aboutir à un nanisme modéré. Plus rarement des anomalies cardiaques, ou rénales, une dysplasie de la hanche.
- Possibilité d’apparition à l’âge adulte le plus souvent d’une cholélithiase, voire de calculs biliaires qui en l’absence de suivi prospectif peuvent des complications graves
- Surcharge en fer pouvant endommager différents organes mais principalement le cœur et le foie.
Prise en charge de la maladie:
La transfusion peut être nécessaire lors de certains épisodes hémolytiques avec une hémoglobine inférieure à 7g/dl et dans le formes graves d’emblée nécessitant un programme transfusionnel régulier. La supplémentation en folates est nécessaire.
L’administration d’interféron (IFN) alpha (éventuellement pégylé) chez les patients porteurs de mutations du gène CDAN1 peut permettre la normalisation de l’hémoglobine quoique certains patients n’y soient pas répondeurs. La surveillance de la surcharge au moins une fois par an est nécessaire. Elle permet une intervention thérapeutique via les saignées que certains patients supportent très bien et par les agents chélateurs du fer dans les autres cas. En cas de surcharge en fer majeure les niveaux de concentration en fer du foie et du myocarde doivent être documentés par une IRM dédiée. Les surcharges en fer hépatiques comportent un risque de cirrhose et au final d’hépatocarcinome ; et l’atteint cardiaque peut entraîner une insuffisance cardiaque globale. Chez les sujets splénectomisés en particulier une hypertension artérielle pulmonaire peut survenir.
Les désordres endocriniens : diabète de type II, hypothyroïdie ou hypoparathyroïdie ; hypogonadisme sont généralement secondaires à un niveau grave de surcharge en fer.
Des sites d’expansion médullaire avec rupture de l’anatomie corticale des os (côtes, rachis++) ou même extra-osseux hématopoïétiques sont à rechercher systématiquement et a fortiori si des symptômes de compression médullaire apparaissent et si un essai de traitement par interféron a ou par EPO doit être effectué
La splénectomie est à éviter autant que possible car un risque de thrombose grave peut lui succéder. L’indication la plus justifiée survient dans les situations où le besoin transfusionnel est aggravé par un hypersplénisme. La surveillance échographique de la vésicule biliaire permet une chirurgie élective endoscopique qui a le mérite de prévenir les complications potentiellement graves et parfois chroniques secondaires aux migrations lithiasiques.
Les défauts de minéralisation osseuse sont fréquents et doivent être documentés et traités pour éviter les fractures pathologiques.
Quelques rares patients ont pu bénéficier d’une transplantation médullaire génoidentique. Elle a été « effectuée chez des patients transfuso-dépendants et ne répondant pas à l’interféron a.
Anémie dysérythropoïétique congénitale type II (CDA II) :
C’est la forme la plus fréquente des CDA. Elle est associée une anémie où les globules rouges sont parfois sphérocytaires mais pas macrocytaires comme pour la CDAI. L’ictère et la splénomégalie sont fréquents les anomalies majeures du développement sont absentes mais des malformations squelettiques peuvent être observées. Sinon toutes les complications décrites pour la CDAI sont observables.
Mode de transmission de la maladie et diagnostic :
Il est identique à celui de la CDAI.
La moëlle osseuse est très riche en précurseurs des globules rouges qui présentent de nombreuses cellules avec deux noyaux identiques. Plus de 10% de cellules binucléées et l’existence de plus de 2% de cellules avec fragmentation du noyau (caryorrhexis) est caractéristique du diagnostic de CDA de type II.
Un aspect de double membrane des globules rouges en microscopie électronique. L’hypo glycosylation de la bande protéique 3 du cytosquelette membranaire en modifie la mobilité électrophorétique et permet d’affirmer le diagnostic.
La mutation concerne le gène SEC23B sur le chromosome 20, entrainant une perte de fonction de la protéine (COP2) qui régule le transport des protéines du réticulum endoplasmique vers l’appareil de Golgi
Signes cliniques :
Une anémie est présente souvent dès la naissance et quelques cas la développe pendant la vie fœtale possiblement traitables par transfusion in utero. Mais dans la majorité des cas l’anémie reste modérée (taux d’hémoglobine autour de 9-10 g/dl) mais avec de possibles accentuations temporaires qui peuvent nécessiter une transfusion sanguine. Les autres symptômes sont identiques à ceux décrits pour la CDAI
Prise en charge de la maladie :
Elle n’est pas différente de celle de la CDAI
Anémie dysérythropoïétique congénitale type III (CDA III)
Dans sa forme typique quoique très rare la CDA de type III est une pathologie de transmission autosomique dominante. Il existe une mutation unique, c[2747C>G] du gène KIF23 (Chromosome 15) qui code pour la protéine MKLP1 indispensable aux divisions cellulaires.
Signes cliniques :
La présentation clinique de cette pathologie est variable. En effet, la CDA III peut se manifester par :
- Une anémie macrocytaire légère à modérée et un ictère chez les nouveau-nés.
- La présence de gigantoblastes, des érythroblastes pouvant avoir jusqu’à 12 noyaux
- Des troubles visuels avec une dégénérescence maculaire
Les signes de la maladie s’intensifient au cours des infections associées ou au cours de la grossesse. Certains cas sporadiques sont associés à une hyperplasie érythroïde sévère, des troubles squelettiques, un déficit intellectuel et une hépatosplénomégalie.
Prise en charge de la maladie :
Dans la plupart des cas, l’anémie est légère. Elle ne nécessite donc pas de traitement. Quelques cas d’anémie extrême peuvent nécessiter une transfusion. Des cas uniques possiblement différents dans leur pathogénie (<20 cas) de même aspect médullaire ont une présentation clinique très différente avec des anomalies du développement, des retards mentaux, et une hépatosplénomégalie.
Information pour tout public
Fiche Orphanet : Orphanet: Anémie dysérythropoïétique congénitale


